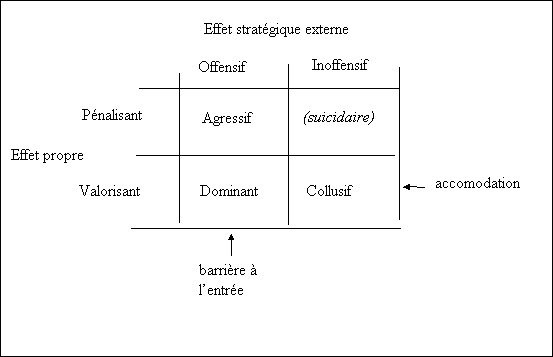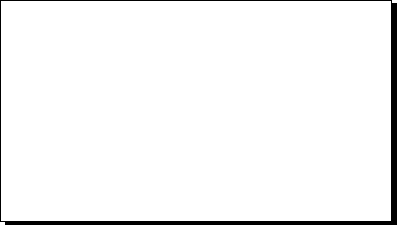1. PARTIE 1 - TARIFICATION NON LINEAIRE, THEORIE ET APPLICATIONS
La pratique de tarifs dégressifs,
l’offre de contrats diversifiés, les ristournes accordées en fonction du
volume, les programmes de fidélisation, les prix spéciaux accordés à certaines
catégories de clients, les abonnements spéciaux ou les forfaits sont autant
d’exemples que la littérature économique regroupe sous le terme générique de
« discrimination » tarifaire (cf. - 6 Mitchell, B.M., Vogelsang, I. (1991), - 7 Mussa, M. Rosen S. (1978), - 13 Wilson R. (1993)).
1.1. Discrimination tarifaire : définitions
D’une manière générale, on dit
qu’il y a discrimination tarifaire lorsqu' une même quantité de produit ou de service est
vendu à des prix différents sans que cette différence de prix soit justifiée
par des considérations de coût ou de qualité.
La littérature distingue cependant
trois degrés de tarification discriminante. . La tarification
discriminante du premier degré correspond à ce que l’usage courant dénomme
« tarification à la tête du client ». Elle consiste à pratiquer des
prix personnalisés. Chacun d’eux est égal au prix maximum que le client est
prêt à payer pour le service. Dans le cadre de notre analyse, nous n’étudierons
pas ce type de discrimination tarifaire : son usage reste en effet nécessairement limité à des
activités dont les prix peuvent être fixés hors catalogue. En revanche les deux
autres degrés de discrimination méritent une étude plus approfondie.
Définition 1-1
Discrimination du 3° degré: on dit qu’il y a discrimination du 3° degré lorsque le prix dépend de caractéristiques observables du client.
Ainsi, les prix spéciaux pour les
entreprises, pour les personnes âgées, pour les jeunes... sont des exemples de
tarification discriminante du 3° degré.
La discrimination du troisième degré correspond donc à une pratique de segmentation
explicite de la clientèle. Elle n’a d’intérêt que lorsque les demandes
diffèrent significativement d’un segment à l’autre.
Définition 1-2
Discrimination du 2° degré: : on dit qu’il y a discrimination du second degré lorsque la tarification du produit est non linéaire : le prix de l’unité marginale supplémentaire dépend de la quantité totale achetée
D’une manière générale on parlera
dans ce cas là de « tarification non linéaire ». La tarification non
linéaire conduit à une segmentation implicite de la clientèle : celle-ci, d’une
certaine manière, s’auto-sélectionne en choisissant un niveau de consommation.
Plusieurs types de tarifications entrent dans cette catégorie selon la forme de
la fonction de tarification : (cf. Erreur !
Source du renvoi introuvable.).
-binôme : fixe (abonnement) + prix constant.
-forfait : facture indépendante
de la consommation
-non linéaire dégressif: le prix
de l’unité supplémentaire décroissant
-non linéaire progressif:: le
prix de l’unité supplémentaire croissant
-optionnel de type binôme : offre de plusieurs tarifs binômes
entre lesquels le client a le choix.
Le tarif binôme est la version la plus simple : elle consiste en une redevance
fixe (abonnement) donnant droit à l’accès à la consommation, et d’un prix
unitaire constant. Le forfait est une tarification indépendante de la
consommation.
Remarquons enfin qu’une
tarification dégressive peut être
obtenue, de manière équivalente par l’offre d’un menu de tarifs binômes
optionnels (cf. Figure).
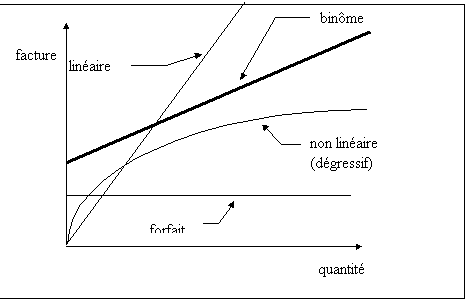
Figure 1-1 tarifs non linéaires
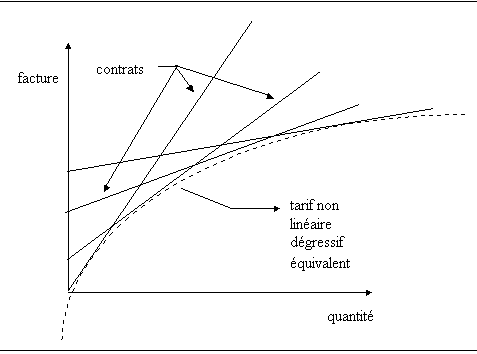
1.2. Faisabilité
La discrimination n’est évidemment réalisable que pour autant que les consommateurs ne
puissent pas arbitrer entre les différents prix.
![]() Pour qu’une tarification dégressive
soit pertinente il faut bien sûr que la revente soit difficile.
Pour qu’une tarification dégressive
soit pertinente il faut bien sûr que la revente soit difficile.
![]() Une tarification progressive n’est
possible que lorsque l’on peut identifier clairement le consommateur, dans le
cas contraire celui-ci pourrait ouvrir plusieurs contrats et consommer sur
chacun d’eux une faible quantité
bénéficiant des conditions avantageuses sur les petits volumes de
consommation.
Une tarification progressive n’est
possible que lorsque l’on peut identifier clairement le consommateur, dans le
cas contraire celui-ci pourrait ouvrir plusieurs contrats et consommer sur
chacun d’eux une faible quantité
bénéficiant des conditions avantageuses sur les petits volumes de
consommation.
Sur les marchés très
concurrentiels, les prix sont tirés vers les coûts marginaux. Ce phénomène
exclut pratiquement la tarification non linéaire de ce type de marchés.
Cependant seulement un très petit nombre de marchés sont parfaitement
concurrentiels. Dans les marchés ou la concurrence est monopolistique, les produits sont suffisamment différenciés
pour bénéficier d’une position de monopole local. Dans les marchés ou la
concurrence est oligopolistique, sur des produits totalement substituables, des
mécanismes stratégiques (cf. partie 2) permettent de limiter la concurrence en prix.
D’une certaine manière, la
faisabilité de la tarification non linéaire est conditionnée par l’existence
d’un certain pouvoir de monopole.
1.3. Justifications économiques de la discrimination
Il existe une littérature
théorique abondante sur les justifications économiques de la discrimination en situation de monopole. Il est clair que la discrimination offre
certains degrés de liberté supplémentaire au monopole (par rapport à la
tarification uniforme); ce qui ne peut
être que favorable à son profit.
Cependant, de nombreux travaux
montrent que la discrimination n’est pas nécessairement préjudiciable à l’intérêt public. . Le cas particulier d’un
monopole public soumis à de forts coûts fixes est à cet égard éclairant. La tarification au coût marginal ne suffit pas à financer les coûts fixes, et une tarification uniforme
peut conduire à l’écrémage du marché (cf. Encadré
1-1 ). La principale conclusion du courant de littérature traitant de la
tarification d’un monopole soumis à la contrainte budgétaire est la suivante : lorsque la tarification au
coût marginal conduit à un déficit structurel, l’optimum (de moindre mal)
conduit à pratiquer un tarif dit de « Ramsey-Boîteux ». Pour ce type
de tarif, lorsque la population est segmentée, le taux de marge doit être
inversement proportionnel à l’élasticité
de la demande. Les segments « élastiques » bénéficient ainsi
d’un tarif proche du coût marginal (et participent faiblement au financement
des coûts fixes), alors que les segments peu
élastiques supportent un prix plus élevé.
Encadré 1-1 Monopole public et discrimination
On considère un monopole public (local) qui produit un
service à coût marginal nul (pour
simplifier) en supportant un coût fixe
égal à 1000 (par an).
La population est composée
de deux types de « clients » potentiels :
-100 clients de type 1 :
chaque client de ce type accorde une valeur 4 (par an) au service
-100 clients de type 2 :
chaque client de ce type accorde une valeur 8 au service.
Remarquons tout d’abord
que le service est « collectivement » rentable :
4X100+8X100=1200>1000
Le bénéfice retiré par les
usagers est supérieur au coût.
Cependant, une tarification uniforme est insuffisante pour financer le
service. En effet, lorsque le prix est supérieur à 4, seuls les clients de
type 2 sont susceptibles de souscrire. La recette maximale est alors, dans ce cas,
obtenue pour un prix égal à 8 : 8X100=800<1000.
Lorsque le prix est
inférieur à 4, les deux types de clients souscrivent mais la recette maximale
est obtenue pour un prix égal à 4 : 4X200=800<1000.
L’obligation de tarif
uniforme conduit dans ce cas à la « non-réalisation » du service.
Seule une tarification discriminante (du 3° ou 2° degré) est susceptible de
restaurer l’efficacité.
1.4. Tarification discriminante optimale, cas monoproduit
De nombreuses contributions
théoriques se sont attachées à caractériser la tarification discriminante
optimale dans le cas d’un monopole privé ou d’un monopole public soumis à contrainte budgétaire. Nous allons donner ici les
principaux résultats sans donner l’intégralité des développements mathématiques
(cf. - 13 Wilson R. (1993), - 7 Mussa, M. Rosen S. (1978).).
1.4.1.Discrimination du troisième degré
Dans le cas de la discrimination du troisième degré, la clientèle est composée de différents
segments, chacun étant caractérisé par une demande homogène. On note ei
l’élasticité de la demande dans le segment i.
Le prix pratiqué sur le segment i est d’autant plus éloigné du coût marginal c que l’élasticité de la demande sur ce segment est faible.
Ainsi, les segments à forte
élasticité sont « moins rentables » au sens où ils participent
moins au profit.
Nous avons déjà remarqué que la
tarification discriminante était impossible lorsque les consommateurs pouvaient
arbitrer (c’est à
dire lorsqu’un marché secondaire était susceptible de se créer). Si le monopole
produit un bien intermédiaire (utilisé par des entreprises de transformation ou
(plus simplement) des détaillants en aval, il peut éviter cette concurrence via les marchés secondaires en adoptant des stratégies « d’
intégration verticale » (cf. - 11 Tirole J (1989)). Supposons
par exemple que le marché du monopole se compose de deux segments tels que
l’élasticité sur le segment 1 soit plus élevée que celle du segment 2. Pour pouvoir mettre en place une discrimination tarifaire il faut en effet empêcher que les entreprises du segment
2 achètent le bien du monopole aux entreprises du segment 1. En s’intégrant
verticalement avec une entreprise du segment 1, le monopole réalise cet objectif :
il affiche un seul prix élevé (le prix du segment 2) et vend en interne au prix
bas (en interdisant à sa filiale la revente aux entreprises du segment 1).
Monopole Détaillant 1 Détaillant 2


![]() fort
fort
![]() faible
faible
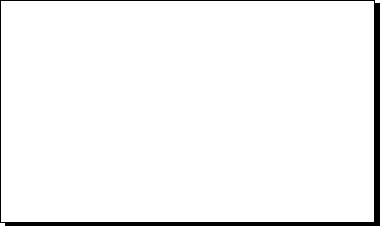
Figure 1-3 Discrimination par intégration verticale
Cette stratégie correspond à la version la plus
simple de la stratégie de «
squeezing » , les biens en aval n’étant pas a priori
concurrents. Nous verrons par la suite, une version plus élaborée de la
pratique de squeeze lorsqu’un
même producteur vend un bien à la fois à une de ses filiales mais aussi à un
des concurrents de sa filiale.
Lorsque le monopole est un
monopole public soumis à l’équilibre budgétaire, le même type de résultat est
obtenu à la différence que le taux de marge est cette fois-ci proportionnel à
l’inverse de l’élasticité, le facteur de proportionnalité étant appelé indice
de Ramsey.
1.4.2.Discrimination du second degré ou tarification non linéaire
Demande homogène
Supposons tout d’abord que tous
les consommateurs (en nombre N) sont identiques. On dira dans ce cas là que la
demande est homogène égale à NQ(p). On peut
montrer facilement (cf. -
11 Tirole J (1989)) dans ces conditions que la tarification non linéaire
optimale est une tarification binôme dans laquelle le prix unitaire est égal au
coût marginal.
propriété 1-2 Tarif optimal pour une demande homogène
Lorsque la demande est homogène, le tarif non linéaire optimal est le tarif binôme composé d’une partie fixe A et d’un prix unitaire égal au coût marginal.
Soit en effet A(p) l’abonnement maximal qu’un
consommateur accepte de payer lorsque le prix unitaire est égal à p. Il est clair que A(p) est une fonction décroissante
de p : lorsque le prix à l’unité est élevé le consommateur accepte moins
volontiers un abonnement élevé. Il est d’autre part facile de voir que lorsque
p varie de p à p+Dp
l’abonnement maximal baisse de ![]() (la surfacturation du
volume doit être exactement compensée par la baisse de l’abonnement). Le profit
du monopole s’écrit :
(la surfacturation du
volume doit être exactement compensée par la baisse de l’abonnement). Le profit
du monopole s’écrit :
![]()
La variation du profit en
fonction du prix s’écrit alors :
![]()
Le profit est donc maximum pour p=c et A=A(c).
Ce résultat est facile à
comprendre : en tarifant l’unité à un prix égal au coût marginal, le monopole incite le
consommateur à une consommation optimale, c’est à dire celle qui dégage un
surplus maximal.
Ce surplus est alors ensuite capturé par le monopole via la prime fixe A.
Le même type de résultat
s’obtient pour le monopole public astreint à l’équilibre budgétaire : dans ce cas l’abonnement est
égal au « coût fixe moyen », c’est à dire au coût fixe divisé par le nombre de
clients.
Demande hétérogène
Lorsque la demande est
hétérogène, l’abonnement maximal acceptable, en contrepartie d’un prix à
l’unité donné, varie d’un consommateur à l’autre. L’idéal (du point de vue du
monopole) serait bien sûr de pratiquer un prix unitaire égal au coût marginal et de fixer un abonnement personnalisé exactement égal à
l’abonnement maximal acceptable. Ce type de tarification correspond à une
discrimination du premier degré et est bien sûr incompatible avec la publication
d’un catalogue.
Une deuxième solution pourrait
consister à fixer le prix au coût marginal et à proposer un abonnement unique. Seuls les clients ayant une
disposition à payer un abonnement supérieur seraient alors consommateurs :
cette politique tarifaire conduit à un écrémage (anti-sélection) qui est en fait sous optimal.
La solution optimale consiste en
fait à proposer un tarif non linéaire (cf. - 13 Wilson R. (1993)). La facture
totale payée n’est dans ce cas pas proportionnelle à la quantité consommée.
Soit T(q) la facture associée à une consommation q. Notons d l’unité élémentaire de consommation.
Ainsi lorsque l’on consomme une quantité totale q, on consomme k=q/d unités élémentaires.
Notons p(q)=T(q)-T(q-d). p(q)
est le prix unitaire de la dernière unité consommée. Si T(0)=0 (ce qui est évident), on a bien sûr :
![]()
Le profit réalisé sur les
consommateurs qui consomment exactement la quantité q est égal à :
![]()
Ecrivons tous les profits de q=0 à l’infini sous la forme suivante :
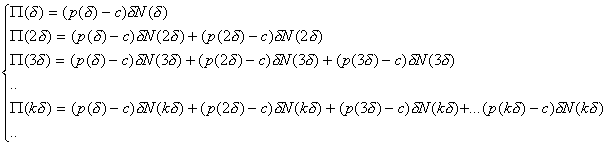 Le profit total est la somme de tous ces profits. On
voit que l’on peut réordonner les termes de la somme en additionnant les termes
verticalement. On obtient alors une somme dont un terme typique est :
Le profit total est la somme de tous ces profits. On
voit que l’on peut réordonner les termes de la somme en additionnant les termes
verticalement. On obtient alors une somme dont un terme typique est :
![]()
Ce terme correspond au profit
réalisé sur la « h ième unité » : il est égal à la marge unitaire (p-c) multiplié par le nombre de
« h ièmes unités » vendues, c’est à dire par le nombre de
consommateurs achetant plus de h
unités a un prix p(hd).
posons alors hd=q , ce profit s’écrit :
![]()
où M(q,p(q)), représente le nombre d’individus achetant une quantité
supérieure à q lorsque le prix de la dernière unité avant q est tarifée au prix p(q).
Le tarif optimal p(q) vérifie donc :
![]()
c’est à dire :
![]()
Dans la formule ci dessus,
l’élasticité représente la variation relative du nombre de consommateurs
consommant plus que q lorsqu’on fait
varier le prix unitaire de l’unité marginale autour de p(q).
propriété 1-3 Tarification non linéaire optimale
Le taux de marge associé à la q ième unité est inversement proportionnel à l’élasticité de la demande sur la q ième unité.
Conséquences :
-Le prix unitaire payé par les plus gros consommateurs est égal au coût marginal.
-En général, avec les distribution usuelles des « types » de consommateurs (Log-normal par exemple), le tarif non linéaire optimal est dégressif (cf. - 13 Wilson R. (1993)).
-Il peut donc s’obtenir comme menu de tarifs binômes. Dans ce menu, le contrat dont l’abonnement est le plus élevé a un prix unitaire égal au coût marginal.
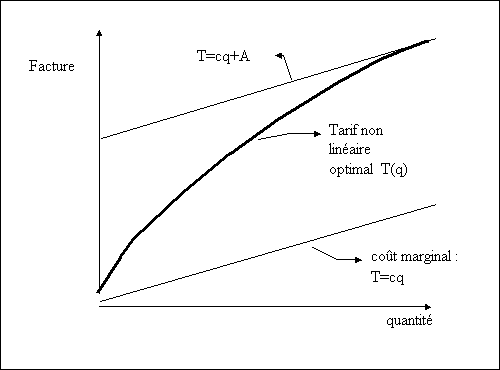
Figure 1-4 Tarif non linéaire optimal
Tarifs binômes
On peut restreindre le tarif non
linéaire à un tarif binôme. Dans ce cas on a le résultat suivant:
propriété 1-4 Tarif binôme optimal
Le tarif binôme optimal (A,p) est tel que :
p est plus grand que le coût marginal mais plus petit que le tarif uniforme optimal.
A est égal à l’abonnement maximal
tolérable du plus petit consommateur servi.
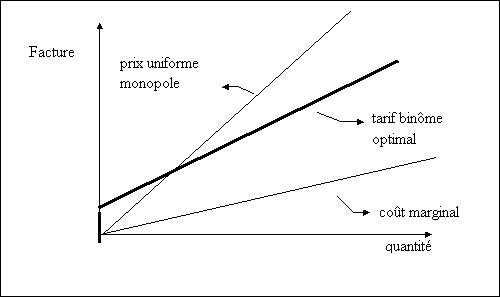
Figure 1-5 Tarif binôme optimal
1.5. Effets de la discrimination sur l’efficacité économique
Analyser l’impact de la
tarification discriminante (et de la tarification non linéaire) sur
l’efficacité économique suppose de disposer d’une référence.
Dans le contexte d’analyse que
nous présentons, la référence naturelle est bien sûr celle du monopole
contraint à une tarification uniforme.
Analysons, pour fixer les idées,
le cas de la discrimination du 3° degré. On doit comparer deux situations :
celle où le monopole affiche un prix unique, tel que le taux de marge soit égal
à l’inverse de l’élasticité totale, et celle où le monopole peut pratiquer
différents prix sur différents segments. Supposons par exemple que les
élasticités sur chacun des segments soient très différentes. Ainsi, supposons
que coexistent sur le marché des petits consommateurs à très forte élasticité
(une petite variation de prix engendre une forte variation de consommation), et
des gros consommateurs à faible élasticité. Dans ce cas on comprend aisément que
contraindre le monopole à pratiquer un tarif unique, l’incite à écrémer le
marché pour profiter de la « rente » qu’il peut obtenir sur les gros
consommateurs.
D’une manière générale, l’impact de
la discrimination sur le bien-être (collectif) est ambigu. On peut cependant
donner l’intuition des principaux résultats :
propriété 1-5 Effets de la discrimination sur le bien-être
-Si la consommation avec discrimination est plus faible que la consommation avec tarification uniforme alors le bien-être collectif diminue avec la discrimination.
- Lorsque la contrainte de tarification uniforme incite le monopole à écrémer (servir uniquement les consommateurs ayant une faible élasticité et une forte demande) alors la discrimination peut être souhaitable.
-Lorsque le monopole est un monopole public soumis à des coûts fixe importants, la discrimination est toujours plus efficace que la tarification uniforme (cf. - 12 Willig, R. (1978)).
Des résultats similaires peuvent
être obtenus dans le cas de la tarification non linéaire. Prenons l’exemple de
la tarification binôme optimale représentée sur la Figure 1-5. On voit que par rapport
à la tarification uniforme monopolistique, la tarification non linéaire est
« plus chère » pour les petits consommateurs que pour les gros.
Cependant, la baisse du prix unitaire rend plus attractives les consommations
élevées.
propriété 1-6 Effet de la tarification non linéaire sur le bien-être
Si la tarification non linéaire est telle que l’écrémage est diminué (c’est à dire que la réduction du prix unitaire incite de nouveaux consommateurs à consommer, alors la tarification non linéaire est plutôt favorable.
Si avec une tarification non linéaire, la consommation totale est diminuée il faut alors préférer la tarification uniforme. (Dans ce cas l’abonnement dissuade les petits consommateurs, ce qui est préjudiciable à l’efficacité)).
1.6. Utilisation stratégique de la tarification non linéaire « effet PolaroïdÔ »
Un cas intéressant d’utilisation
de la tarification non linéaire est illustré par le cas Polaroïd.
Une entreprise possède une
situation de monopole sur un produit de base consommé en quantité fixe (un
appareil photo, le raccordement à un réseau), alors qu’un bien complémentaire est consommé en
quantités variables (pellicule, trafic). Ce bien complémentaire peut
être fourni par un secteur parfaitement concurrentiel au prix p égal au coût
marginal c. Ce bien complémentaire est parfaitement inutile si l’on ne dispose
pas du bien de base. L’idée consiste alors à utiliser le niveau de consommation
en bien complémentaire comme indicateur du consentement à payer le bien de
base. Si l’on fait l’hypothèse que le
consentement à payer le bien de base est positivement corrélé avec la quantité
consommée du bien complémentaire, c’est à dire que (à prix donné) les gros
consommateurs ont un consentement à payer le bien de base plus élevé que les
petits consommateurs, alors utiliser la quantité de bien complémentaire acheté
comme indicateur du consentement à payer le bien de base peut permettre au
monopole de différencier efficacement le prix du bien de base.
Considérons alors le tarif non
linéaire optimal T(q) défini dans le
paragraphe précédent. Le monopole a intérêt à tarifer le bien de base au tarif
T(q)-cq. Ce type de discrimination conduirait à faire payer le bien de base peu
cher par les « petits consommateurs » du bien complémentaire et
relativement cher par les « gros consommateurs » du bien
complémentaire. .
En général, il est difficile
d’observer la quantité de bien complémentaire acheté par ses clients. La
solution consiste alors à pratiquer une vente liée c’est à dire à s’assurer
l’exclusivité de la fourniture du bien complémentaire (par exemple en devenant
« détaillant » du produit complémentaire). Le profit retiré par le
monopole est alors exactement le même. La vente liée est ici « non stratégique » au sens où le monopole
pourrait réaliser le même profit en indexant son prix sur la consommation du
bien produit par un secteur concurrentiel. Le monopole n’a pas intérêt à
modifier les conditions de production et de concurrence sur le bien complémentaire, son objectif consiste simplement à
utiliser la consommation du bien complémentaire comme indicateur du consentement
à payer le bien de base.
Le tarif global ressenti par le
consommateur est alors égal à T(q). Tout se passe comme si le bien de base
était vendu gratuitement et que la consommation du bien complémentaire était
assortie d’un tarif dégressif.
Les exemples de telles pratiques
sont nombreux : offre de terminaux (à des prix faibles) en contrepartie de la
souscription à un abonnement de consommation. Appareils photo vendus peu cher
en contrepartie de l’exclusivité de la vente de pellicules spécifiques.
L’effet sur le bien être d’une
telle pratique est plutôt négatif par rapport à une situation dans laquelle le
produit complémentaire serait vendu au prix c. En effet, la tarification non
linéaire distord le prix du bien complémentaire et l’écarte du coût marginal.
On a le résultat suivant :
propriété 1-7 "Effet Polaroïd" et bien-être
Si le monopole sert le même marché dans les deux configurations alors la vente liée de type « effet Polaroïd » est préjudiciable à l’intérêt collectif.
Si en revanche cette stratégie permet d’acquérir de nouveaux consommateurs alors l’effet peut être positif.
Encadré 1-2 "effet Polaroïd" en tarif binôme
Le monopole produit un
bien de base. Le coût unitaire de production est donné égal à c0. un
bien complémentaire peut être produit au coût marginal c.
Si le monopole pratique
une vente liée le tarif proposé pour une unité de bien de base et q unités de
bien complémentaire est égal à A+pq où A est l’abonnement maximal acceptable au
prix p par le plus petit consommateur et p est un prix unitaire supérieur à c
(cf Figure 1-5).
Remarquons que A est
indépendant de c0 : il peut arriver que A soit inférieur à c0
(par exemple pour la vente de terminaux portables).
Si l’on interdit la vente
liée le prix du bien complémentaire sera offert au prix c. Le prix du
monopole (s’il sert le même marché) sera égal au consentement à payer du plus
petit consommateur au prix c, consentement à payer qui est plus grand que A.
Lorsqu’on interdit la
vente liée et que cette interdiction ne modifie pas la taille du marché,
alors on augmente l’efficacité économique globale. Si cette interdiction
conduit à l’écrémage, alors la conclusion peut être inversée.
1.7. Tarification non linéaire et régulation
Dans de nombreux secteurs, les monopoles
sont soumis à des contraintes de régulation. Nous n’entrerons pas ici
dans la discussion sur la définition des mécanismes de régulation. L’objectif
consiste ici à estimer l’impact de la régulation sur la stratégie tarifaire du monopole.
La régulation par price cap est un type de mécanisme qui a pour double vertu d’inciter le
monopole à minimiser ses coûts et à l’empêcher de « trop » profiter
de sa rente de monopole.
Lorsque le monopole propose une
tarification non linéaire se pose le problème de la définition du price cap.
Deux options sont possibles :
-la première consiste à imposer ![]() : le tarif non linéaire doit être telle que la facture totale
d’un client ne doit pas excéder une facture linéaire donnée. En général on
prendra comme price cap « l’ancien » prix linéaire.
: le tarif non linéaire doit être telle que la facture totale
d’un client ne doit pas excéder une facture linéaire donnée. En général on
prendra comme price cap « l’ancien » prix linéaire.
-la seconde consiste à imposer
que la recette totale du monopole n’excède pas une recette linéaire donnée: ![]() où Q représente la
quantité totale vendue.
où Q représente la
quantité totale vendue.
La deuxième solution est celle
d’un price cap moyen : le prix moyen payé sur le marché du produit en question ne
doit pas excéder un prix donné.
Armstrong et ali (cf. - 1 Armstrong M. Cowan
S, Vickers J (1995)) étudient l’effet sur le bien être total des deux
types de régulation.
Le principal résultat est le
suivant :
propriété 1-8 Tarification non linéaire et price cap
Le monopole préfère le price cap moyen. Ses degrés de liberté sont supérieurs dans la définition du tarif non linéaire optimal. Ce type de régulation peut cependant conduire à inciter le monopole à pratiquer des prix unitaires inférieurs au coût marginal. Cette caractéristique a donc un impact anti-concurrentiel indirect : elle protege le monopole sur les segments hauts du marché.
Les consommateurs préfèrent la tarification non linéaire avec price cap sur facture à la tarification uniforme. Cependant la comparaison entre price cap sur facture et price cap moyen est moins claire. On peut simplement affirmer que le premier type de régulation a la vertu de « protéger » les petits consommateurs.
1.8. Tarification non linéaire multiproduit
La tarification non linéaire
multiproduit fait l’objet de recherches actives et non encore achevées. On peut
cependant donner quelques intuitions sur certains résultats intéressants (cf. - 9 Rochet J.C. (1996)).
Considérant un monopole
produisant deux biens indépendants 1 et 2. (local, longue distance par
exemple). Les acheteurs potentiels diffèrent par leur propension à payer chacun
des deux biens. On peut par exemple imaginer qu’il existe 4 types de
consommateurs : ceux qui ont un consentement à payer fort sur les deux biens
(type 1) , ceux qui ont un consentement à payer faible sur les deux biens (type
2), et ceux qui ont un consentement à payer fort sur l’un et faible sur
l’autre. (type 3 et 4).
Si il y a une très forte
corrélation positive entre les consentements à payer (les types 3 et 4 sont
très faiblement représentés), alors tout se passe comme s’il n’existait qu’un
seul bien composite. La tarification non linéaire optimale est dans ce cas là
séparable : elle consiste à pratiquer la tarification non linéaire optimale sur
chacun des deux marchés.
Le cas le plus intéressant est
celui ou la corrélation est fortement négative, c’est à dire lorsque les types
3 et 4 sont très fortement majoritaires. Le monopole a alors intérêt a offrir
un contrat dans lequel l’un des prix
unitaires est inférieur au coût marginal. Supposons par exemple que les
individus ayant un fort consentement à payer le bien 1 et un faible
consentement à payer le bien 2 (type 3)
soient fortement majoritaires. Ce type constitue d’une certaine manière
la « cible du monopole ». Ce type consomme un panier composé en
grande partie de bien 1. L’optimum consiste à proposer à cette cible un prix
unitaire égal au coût marginal sur chacun des deux biens contre un abonnement
donné. Le contrat proposé au type 4 doit alors être tel que les individus de
type 3 n’aient pas intérêt à y souscrire. Pour cela il faut afficher un prix
unitaire supérieur au coût marginal sur le bien 1 et inférieur sur le bien 2.
Le prix unitaire du bien 2 croit avec le volume consommé sur le bien 1 et passe
d’une valeur inférieure au coût marginal à une valeur égale au coût marginal.
Nous reviendrons plus loin sur
les similitudes entre tarification non linéaire multiproduits et ventes liées.
1.9. Tarification non linéaire et concurrence
Des contributions récentes ont
étendu l’analyse de la tarification non linéaire au cas de la concurrence (cf. - 2 Biglaiser Mezzetti (1993),- 5 Martimort D. Ivaldi M.(1992),- 10 Stole L. (1995),- 13 Wilson R. (1993))
D’une manière générale, si les
biens en concurrence sont parfaitement substituables et produits dans les mêmes conditions
par les entreprises en concurrence, alors il n’existe pas d’équilibre
concurrentiel avec tarification non linéaire.
En revanche, dès que les biens
sont différenciés, il peut exister des équilibres en tarification non linéaire.
Lorsque la différenciation est horizontale, c’est à dire lorsque les
consentements à payer les biens sont corrélés négativement (ceux qui ont un
consentement à payer élevé pour un des biens ont aussi un consentement faible à
payer l’autre), alors le tarif non linéaire d’équilibre est très similaire au
tarif monopolistique (cf. - 10 Stole L. (1995)).
Tout se passe comme si les concurrents étaient en situation de monopole local
sur des clients peu mobiles.
En revanche si la différenciation
est verticale (la corrélation entre les consentements à payer est forte) alors
la concurrence est plus frontale. Dans ce cas le tarif non linéaire d’équilibre
est plus proche du coût marginal que le tarif de monopole (cf. - 5 Martimort D. Ivaldi M.(1992)).
Lorsque les conditions de
production ne sont pas identiques, c’est à dire par exemple lorsque servir un
client suppose un coût fixe par client et un coût marginal associé à la
quantité et que les deux entreprises diffèrent l’une ayant un coût fixe élevé
et un coût marginal faible l’autre ayant une structure de coût inverse,
l’équilibre en tarif non linéaire peut conduire à un partage de marché dans
lequel la concurrence frontale n’a lieu que pour les consommateurs
« intermédiaires » (cf. -
2 Biglaiser Mezzetti (1993)).